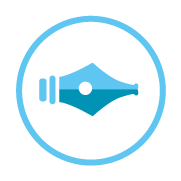
Auteur
Article
Le cœur d’EUSO Ballon
Les yeux de cette expérience de détection des gerbes de rayons cosmiques sont le résultat de plusieurs avancées majeures. Voici un zoom sur les défis technologiques qui ont été relevés pour réussir les vols de ballons démonstrateurs de futures expériences (en fin de page).
Le module de détection EUSO
Le module de photodétection (PDM) constitue la brique élémentaire permettant la construction de la surface focale d’un télescope spatial à rayons cosmiques d’ultra-haute énergie (au-delà de 1019 eV). Il consiste en une matrice de 6x6 MAPMTs de 64 pixels (et de leur filtre UV) assemblée avec son électronique.
Le premier niveau d’électronique est constitué d’ASICs SPACIROC 3, développés spécifiquement pour l’expérience au sein de l’IN2P3 par le groupe Oméga (CNRS/École polytechnique), dédiés à la lecture des signaux et à leur numérisation. Cette électronique de lecture produit un échantillonnage temporel avec une unité de temps de 2.5 µs, correspondant au temps typique de traversée d’un pixel par la lumière émanant d’une gerbe cosmique se développant dans le champ de vue. Au sein de cette fenêtre, la résolution temporelle des ASICs est de 10 ns, et leur dynamique de comptage de photons est linéaire, comprise entre 1/3 photo-électron à environ 100 photo-électrons.
Les signaux produits sont ensuite collectés par une carte FPGA, dont le rôle est de gérer le premier niveau de trigger ainsi que l’acquisition des données. Des générateurs hautes-tensions de très basse consommation (de type Cockcroft-Walton) sont par ailleurs chargés d’alimenter les MAPMTs et sont directement intégrés à l’intérieur des unités de détection. De cette manière, elles agissent comme des briques indépendantes, pouvant être assemblées à grande échelle par simple juxtaposition.
 |
 |
Fig.1 : À gauche : CAO éclatée du module de photodétection (PDM). À droite : module de détection (PDM) composé de 2304 pixels (400.000 images par seconde)
 En outre, les photomultiplicateurs sont protégés des fortes variations d’intensité lumineuse, qui pourraient engendrer de forts courants sur les dernières dynodes et l’anode finissant par les endommager. À cette fin, le PDM intègre un système de commutateurs qui modifient automatiquement la tension de la photocathode avec un temps de réponse de l’ordre de la microseconde. Dans la mesure où les tensions sur les dynodes demeurent inchangées dans ce processus, le retour au fonctionnement nominal est extrêmement bref.
En outre, les photomultiplicateurs sont protégés des fortes variations d’intensité lumineuse, qui pourraient engendrer de forts courants sur les dernières dynodes et l’anode finissant par les endommager. À cette fin, le PDM intègre un système de commutateurs qui modifient automatiquement la tension de la photocathode avec un temps de réponse de l’ordre de la microseconde. Dans la mesure où les tensions sur les dynodes demeurent inchangées dans ce processus, le retour au fonctionnement nominal est extrêmement bref.
Fig.2 (ci-contre) : Diagramme présentant la logique de l’algorithme actionnant les commutateurs des Cockcroft-Walton.
Les principales spécifications de la surface focale sont :
- la détection des photons de fluorescence UV (Ultra-Violet) ;
- la sensibilité au photon unique dans la gamme spectrale 290–430 nm ;
- la capacité d’imager le développement des gerbes avec une résolution temporelle de l’ordre de la µs ;
- un « cross talk » entre pixels voisins inférieur à 10%;
- une fréquence du bruit interne du photo-détecteur de deux ordres de grandeurs inférieure à la fréquence de détection du « night glow » (principale source de lumière diffuse dans le ciel nocturne sans Lune).
Plusieurs modules de photodétection développés, testés et calibrés par les équipes de l’APC (CNRS/Université Paris Diderot/CEA/Observatoire de Paris), du LAL (CNRS/Université Paris-Sud) et d’Oméga ont été mis en œuvre avec succès dans le cadre de missions pathfinders de la collaboration internationale JEM-EUSO (16 pays, 350 chercheurs) :
- mission EUSO-Ballon (août 2014, Canada) : vol d’une nuit sous un ballon stratosphérique ouvert, sous l’égide du CNES et sous la responsabilité de l’APC ;
- instrument EUSO-TA (2015–2016, USA) : partenariat avec la collaboration Telescope Array, campagnes communes de prises de données au sol ;
- EUSO-SPB (mai 2017, Nouvelle-Zélande) : vol de longue durée sous un ballon stratosphérique pressurisé, sous l’égide de la NASA ;
- Mini-EUSO (décembre 2018, ISS) : opération d’un PDM à bord de la station spatiale internationale, sous l’égide des agences spatiales russe et italienne, ROSCOSMOS et ASI.
 |
 |
 |
 |
Fig.3 : Les quatre pathfinders EUSO : EUSO-Ballon 2014 (en haut à gauche), EUSO-TA 2015–16 (en bas à gauche), EUSO-SPB 2017 (en haut à droite) et mini-EUSO 2018 (en bas à droite)
 |
 |
 |
Fig.4 : Détection d’un événement d’origine inconnue traversant le champ de vue d’EUSO-SPB lors du vol de 2017. Les images montrent le nombre de photo-électrons détectés par chacun des pixels sur trois unités de temps consécutives.
Forte de ces succès, la collaboration JEM-EUSO a soumis à la NASA le proposal POEMMA (Probe of Extreme Multi-Messenger Astronomy) dans le cadre du programme Probe Mission pour son prochain plan décennal. Cette mission étendra les objectifs de JEM-EUSO à la détection des gerbes de neutrinos cosmogéniques (associés à l’interaction des UHECRs avec le CMB) et des neutrinos astrophysiques à partir de 3´1016 eV, faisant ainsi la jonction avec les neutrinos d’IceCube (et de KM3Net). La mission POEMMA, dont l’instrument utilise le PDM des pathfinders EUSO, fait partie des 8 sélectionnées et financées par la NASA en tant que Probe Study (qui permettra à la NASA d’établir ses recommandations définitives pour les missions futures fin 2018).
En parallèle, la NASA vient de sélectionner la mission EUSO-SPB2 (vol de longue durée sous ballon stratosphérique), prochaine étape clé de la collaboration JEM-EUSO, conçue comme pathfinder de POEMMA.
Une sélections de photos et vidéos des diverses expériences de la saga EUSO qui emportent le PDM
|
Lancement EUSO-SPB |
Equipe EUSO-SPB |
Emplacement dans l’ISS d’mini-EUSO |
Plan focal JEM-EUSO |
| EUSO-SPB 2017 | EUSO-Ballon 2014 |




